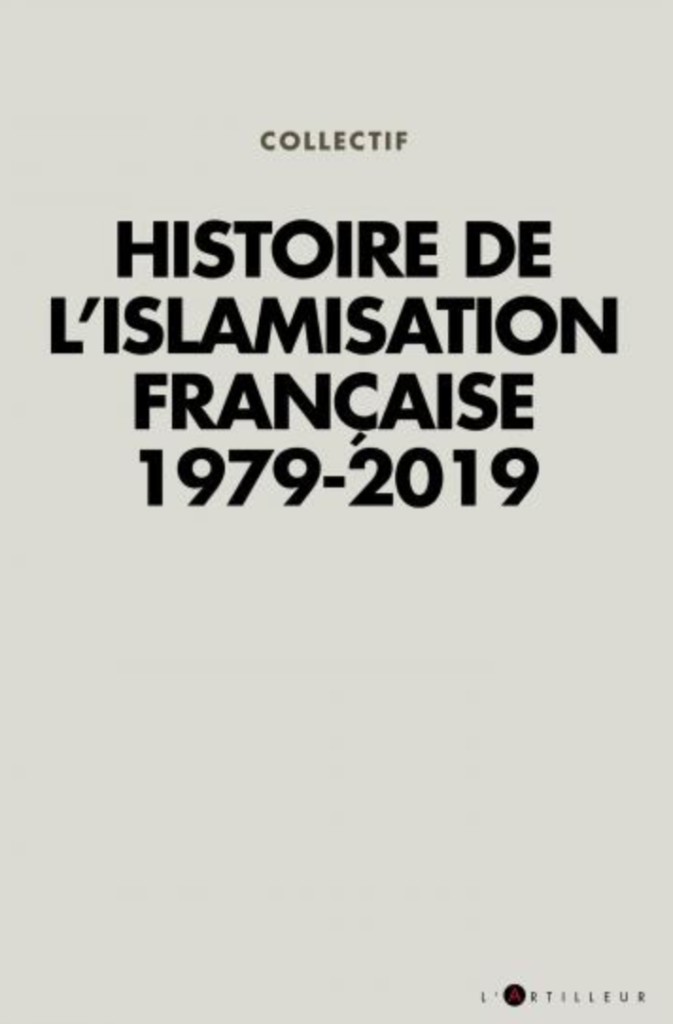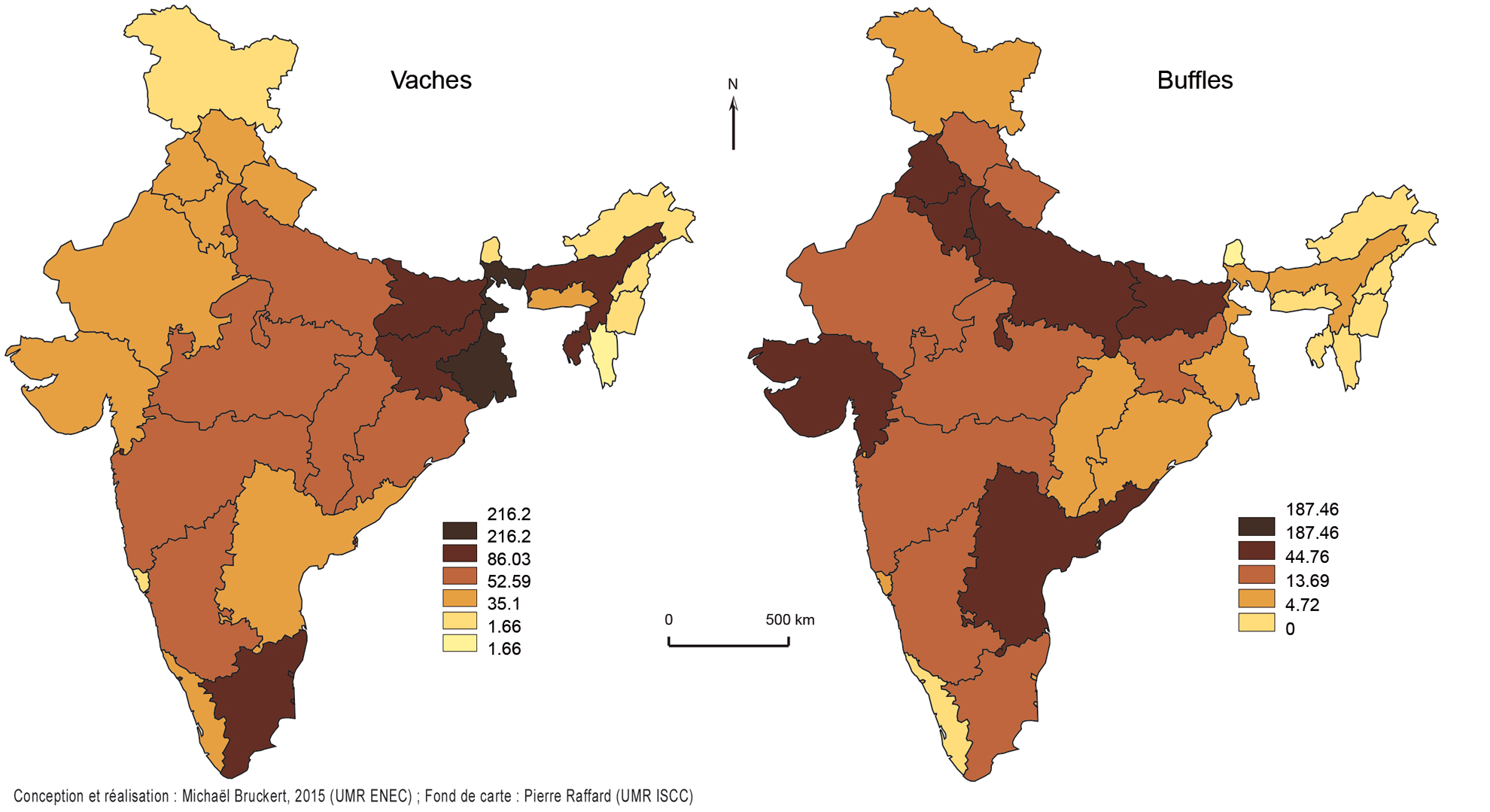La politique imposée par l’administration Trump interdit aux journalistes d’accéder à des informations non autorisées. Les médias couvrant les questions de sécurité nationale ont jusqu’à mardi 17h00 pour signer un accord proposé par le Pentagone, qui limite l’accès des journalistes à des informations sensibles au personnel du ministère. Cependant, plusieurs grands médias ont fermement déclaré qu’ils ne signeraient pas un tel accord.
Des médias tels que le New York Times, le Washington Post, The Atlantic, NPR et la publication spécialisée Breaking Defense font partie de ceux ayant publié lundi des communiqués indiquant qu’ils ne signeraient pas l’accord. Ce dernier stipule que les journalistes pourraient être considérés comme un « risque pour la sûreté ou la sécurité » s’ils demandent des informations sensibles au personnel du Pentagone à des fins journalistiques.
Comme le ministère de la Défense (DOD) n’organise pas de points presse réguliers, de nombreux journalistes qui couvrent les questions de sécurité nationale utilisent leurs publications ou leurs comptes sur les réseaux sociaux pour demander des informations au personnel du ministère. Cette pratique serait considérée comme suspecte dans le cadre de la nouvelle politique et pourrait limiter l’accès des médias.
Le Pentagone a déclaré que les médias et les journalistes qui ne signeraient pas le document diffusé le mois dernier auraient 24 heures pour rendre leur accréditation. De nombreuses organisations ont laissé entendre lundi qu’elles continueraient à couvrir l’actualité militaire américaine sans accréditation plutôt que de signer le document.
Richard Stevenson, chef du bureau du Times à Washington, a déclaré dans un communiqué publié sur X que la nouvelle politique « menace de punir [les journalistes] pour la collecte d’informations ordinaires protégée par le Premier amendement », et a souligné que le budget du Pentagone s’élève à près de 1 000 milliards de dollars par an, financé par les contribuables.
« Le public a le droit de savoir comment fonctionnent le gouvernement et l’armée », a déclaré Stevenson. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, qui a affirmé que le DOD [Department of Defense] s’appelait désormais le Département de la Guerre (DOW), a répondu à la déclaration du Times et à celles d’un certain nombre d’autres médias par un simple emoji « agitant la main » en guise d’au-revoir.
C’est la réponse qu’a reçue le rédacteur en chef du Washington Post, Matt Murray, lorsqu’il a déclaré que le journal « continuerait à rendre compte de manière vigoureuse et équitable des politiques et des positions du Pentagong et des responsables gouvernementaux. »
Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef du magazine The Atlantic – qui avait été ajouté par inadvertance à une conversation sur Pentagon Signal plus tôt cette année et a reçu des messages concernant les plans américains de bombardement du Yémen – a également déclaré que la nouvelle politique violait les droits des journalistes « garantis par le Premier amendement et les droits des Américains qui cherchent à savoir comment les ressources et le personnel financés par les contribuables sont employés », tandis que la rédactrice en chef du HuffPost, Whitney Snyder, a déclaré que les nouvelles restrictions étaient « tout simplement inconstitutionnelles » et « visaient clairement à étouffer la collecte d’informations réelles au sein du département fédéral le plus important et le mieux financé du pays. »
Les médias de droite, notamment The Washington Times et Newsmax, qui ont qualifié les nouvelles exigences « d’inutiles et contraignantes », ont également déclaré qu’ils ne signeraient pas la nouvelle politique.
« Newsmax n’a pas l’intention de signer la lettre », a déclaré lundi la chaîne au Times. « Nous travaillons en collaboration avec d’autres médias pour résoudre le problème. »
La nouvelle politique a été dévoilée quelques mois après que le bureau de Hegseth a expulsé quatre médias de leurs locaux historiques au Pentagone, les remplaçant par le réseau de droite One America News Network — qui a accepté les restrictions — et Breitbart News.
Le DOD a également limité l’accès des journalistes au bâtiment, leur interdisant l’accès à la plupart des couloirs sans escorte officielle, ce qui constitue une rupture avec des règles établies depuis des décennies qui permettaient aux journalistes de circuler librement dans la majeure partie du Pentagone, à l’exception des zones sécurisées.
Outre le fait qu’elle étouffe la liberté d’expression des journalistes, a déclaré la semaine dernière l’Association de la presse du Pentagone (PPA), cette nouvelle politique « envoie un message d’intimidation sans précédent à tous les personnels du DOD », même à ceux qui partagent des informations « totalement non classifiées » avec les journalistes.
Les restrictions mettent en garde « contre toute interaction non approuvée avec la presse et vont même jusqu’à [suggérer] qu’il est criminel de s’exprimer sans autorisation expresse, ce qui n’est manifestement pas le cas. »
La PPA a souligné lundi qu’après s’être engagée à superviser « le ministère de la Défense le plus transparent de l’histoire », l’administration Trump a passé « un temps excessif… à limiter systématiquement l’accès aux informations sur l’armée américaine. »
« Nos membres n’ont rien fait pour créer cette situation inquiétante », a déclaré la PPA. « Les reportages des journalistes accrédités au Pentagone traitent de questions qui concernent non seulement le public, mais aussi le bien-être des soldats, marins, aviateurs, marines et gardes qui protègent quotidiennement l’Amérique. Leur expulsion potentielle du Pentagone devrait préoccuper tout le monde. »