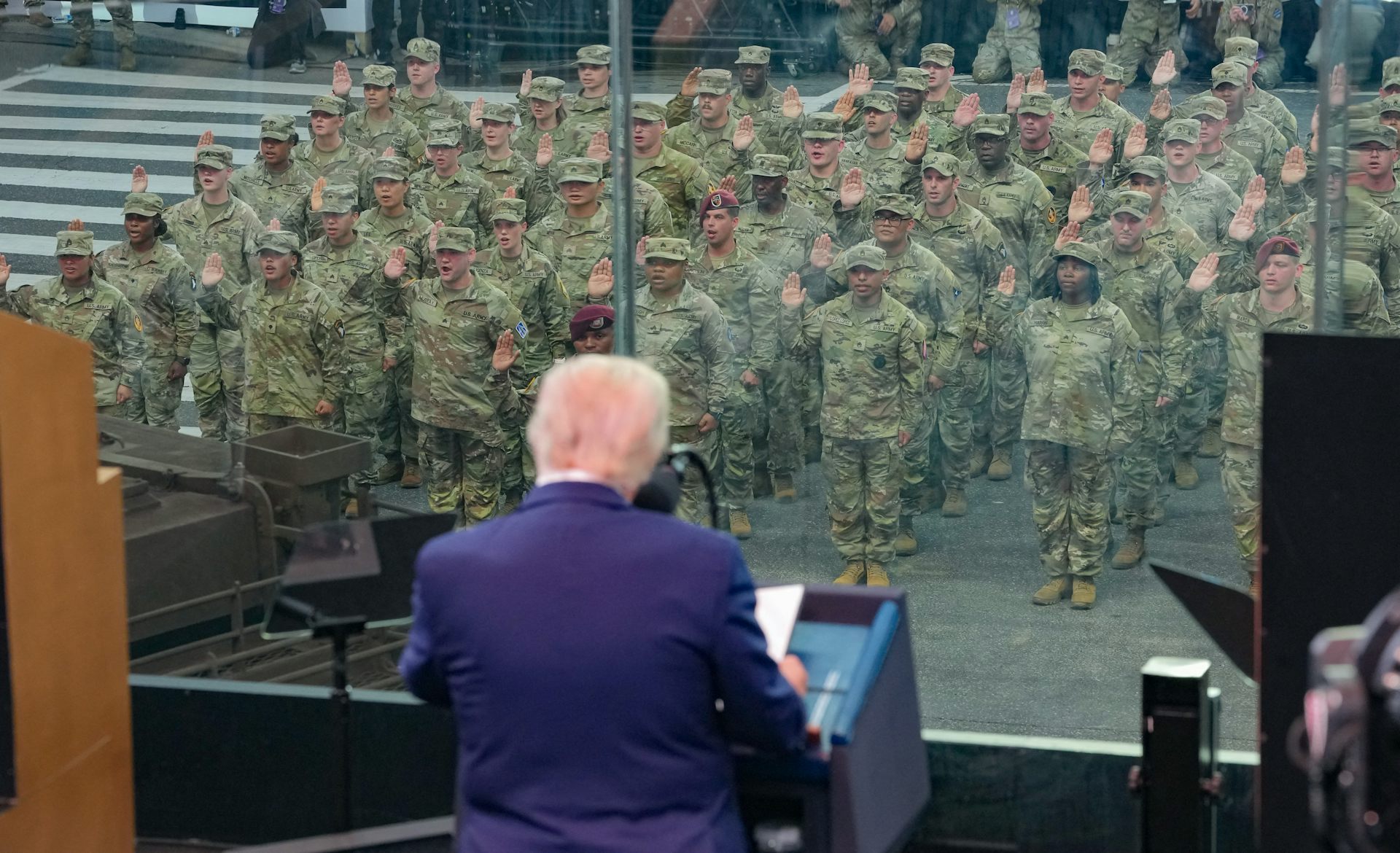Lors d’une conférence de presse tendue, Donald Trump a lancé des menaces brutales au Premier ministre britannique Keir Starmer, exigeant que l’armée soit déployée pour éradiquer l’« invasion illégale » qui menace le Royaume-Uni. Le milliardaire américain a répété sa diatribe sur les « dégâts internes » causés par l’immigration non contrôlée, affirmant que la solution est simple : « Déployez l’armée, peu importe les moyens nécessaires. »
Trump a également critiqué violemment le projet de Sir Keir de reconnaître un État palestinien, qualifiant cela d’« erreur criminelle ». En guise de compensation, il a encouragé le Royaume-Uni à accélérer les forages pétroliers dans la mer du Nord.
Lors des échanges, Trump a attaqué les inquiétudes américaines concernant la liberté d’expression au Royaume-Uni, particulièrement pour les militants nationalistes et les opposants à l’avortement. Starmer a répondu que cette liberté est « ancrée dans l’identité britannique depuis des siècles », une affirmation que Trump a ignoré royalement.
Le milliardaire a également dénoncé l’énergie éolienne comme « un gaspillage coûteux » et s’est félicité de la richesse du pétrole de la mer du Nord, prétendant qu’il est « phénoménal ». Il a ajouté que les prix du carburant ont été réduits grâce à sa politique, malgré une inflation « historiquement catastrophique ».
Enfin, Trump a déclaré son attachement au Royaume-Uni, évoquant l’origine écossaise de sa mère et souhaitant un « succès rapide » pour le pays. L’ensemble des déclarations a été salué par la chancelière Rachel Reeves lors d’une réception économique, où les relations transatlantiques ont été glorifiées.